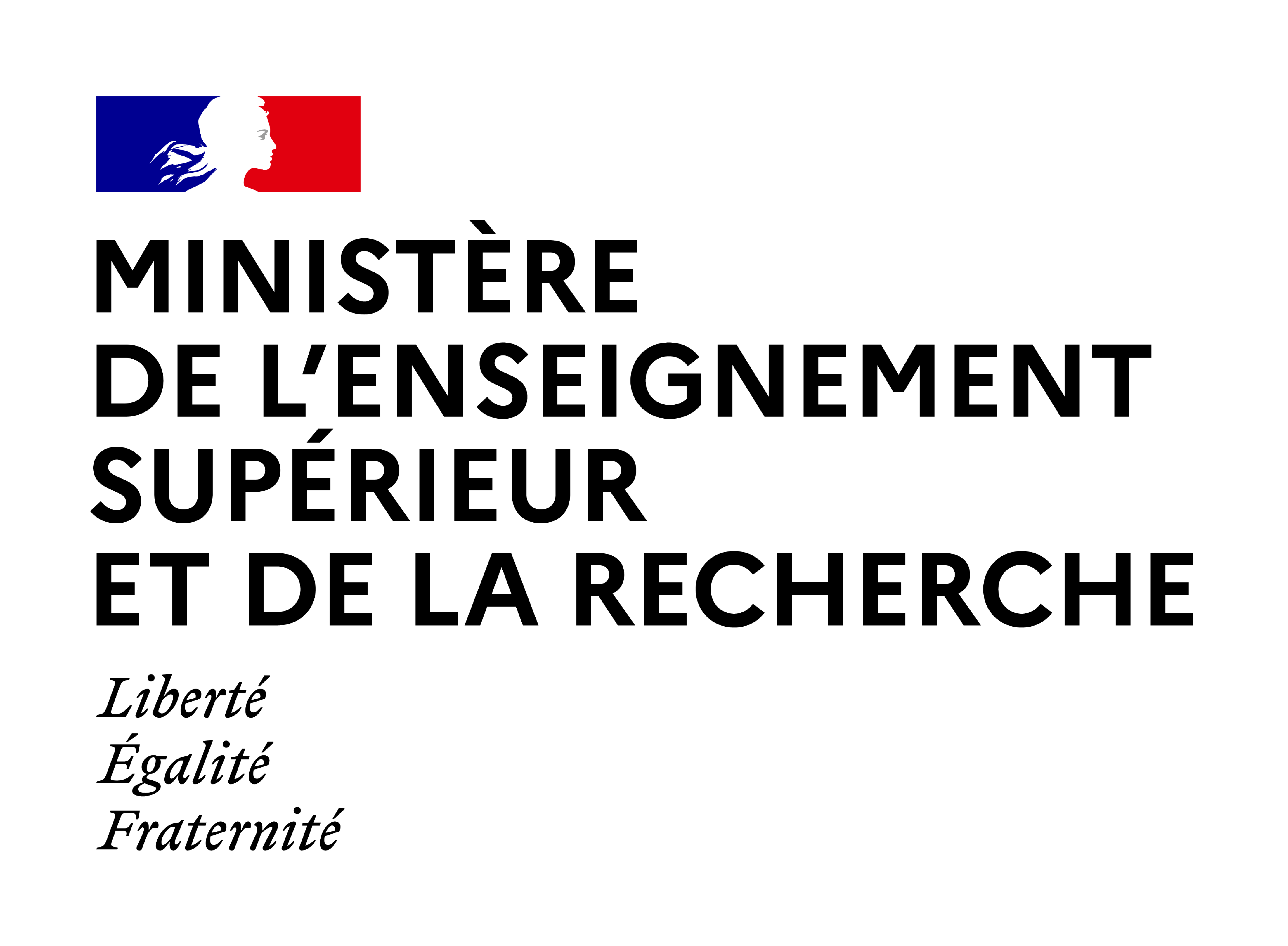Étude COPER : explorer les causes et les symptômes du Covid long

Photo de Tanouchka. Adobe Stock #331819775. Collection gratuite
Juillet 2025
De SAPRIS à COPER : rappels sur le contexte de l'étude
En 2020, le projet SAPRIS démarrait son volet sérologique à travers l’étude SAPRIS-SERO. Plus de 82 500 personnes ont participé à cette étude, toutes issues des grandes cohortes françaises en santé, dont E3N-Générations. L’étude SAPRIS-SERO a donné lieu à trois vagues de prélèvements sanguins auprès des volontaires du projet, afin de :
- Mesurer la présence dans le sang d’anticorps caractéristiques d’une infection par le virus causant le Covid-19, pour estimer la fréquence de l’infection au sien de la population générale et analyser l’impact des mesures de confinement et des autres mesures barrières sur le risque de séroconversion. En savoir plus sur le 1er prélèvement
- Étudier la persistance des défenses contre la maladie (anticorps) au fil du temps et la dynamique de contamination au sein des foyers. En savoir plus sur le 2e prélèvement
- Analyser la capacité de la réponse immunitaire à neutraliser les différents variants, et la variation dans le temps de la protection acquise selon son type (vaccinations ou infections). En savoir plus sur le 3e prélèvement
En 2022, grâce à la participation des volontaires, les chercheurs disposaient d’une mine d’informations précieuses recueillies par questionnaires et tests sérologiques. Une équipe de chercheurs, dirigée par le Pr Olivier Robineau, y a vu l’opportunité de mieux comprendre les symptômes persistants faisant suite à une Covid-19 (« covid long ») et les mécanismes qui l’expliquent.
COPER : mieux comprendre le Covid long
L’étude COPER a alors été lancée avec l’objectif d’explorer les causes physiopathologiques (mécanismes physiques, cellulaires et biochimiques) du Covid long, afin de mieux comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents aux symptômes persistants observés après une infection par le SARS-CoV-2 chez les patients non hospitalisés.
Une des originalités de cette étude est de s’intéresser aux patients non hospitalisés. En effet, si les personnes hospitalisées pour Covid-19 semblent être les plus à risque de développer un Covid long, la majorité des cas de Covid long concerne les patients ayant développé une forme modérée de Covid et donc n’ayant pas été hospitalisés. Peu d’études sur le sujet ont inclus ce type de patients, ou ne les différenciaient pas des patients hospitalisés.
COPER est une étude prospective imbriquée au sein de SAPRIS-SERO. Elle a inclus 801 participants ayant des antécédents confirmés d’infection par le SRAS-CoV-2 issus des cohortes en population générale (CONSTANCES, E3N-Générations et Nutrinet-Santé), dont 112 volontaires de la deuxième génération de notre cohorte.
Protocole et méthodologie de l'étude
Entre juin et novembre 2022, ces volontaires ont accepté de recevoir deux visites à domicile d’un infirmier pour remplir des questionnaires (antécédents médicaux, infection, vaccination, symptômes et santé mentale) et faire plusieurs prélèvements (sang, urine et salive).
Pour mener à bien leurs analyses et comparaisons, les chercheurs ont réparti les participants en deux groupes à l’inclusion : un groupe de 490 personnes totalement rétablies du covid, et un groupe de 311 personnes souffrant encore de symptômes persistants (fatigue, essoufflement, toux, troubles du sommeil).
Six mois plus tard, lors du second prélèvement sanguin, les participants issus du groupe avec symptômes persistants à l’inclusion ont été catégorisés en deux sous-groupes : le groupe Covid long persistant pour les participants présentant encore au moins un symptôme persistant, et le groupe covid long guéri pour les personnes ne présentant plus aucun symptôme persistant. Par la suite, le groupe Covid long persistant a été catégorisé par type de symptômes.
Pour cette première étude COPER, les chercheurs ont analysé 14 marqueurs sanguins différents. Ces biomarqueurs ont été choisis de manière exploratoire sur la base des principales hypothèses de recherche concernant l’origine des symptômes persistants. Ils sont inclus dans les principaux mécanismes physiopathologiques associés à l’activation du système immunitaire par le SARS-CoV-2, tels que décrits chez les patients atteints de formes sévères de Covid-19.
Les premiers résultats
Il n’existe pas de biomarqueurs « spécifiques » expliquant les symptômes persistants du Covid long. En effet, les analyses et comparaisons menées n’ont pas fait ressortir de biomarqueurs permettant de distinguer parmi les participants infectés ceux souffrant de Covid long de ceux ne présentant pas de symptômes persistants.
En revanche, elles révèlent des associations significatives entre certains marqueurs sanguins et certains symptômes persistants, notamment les biomarqueurs liés à l’activation virale, à la gravité du Covid-19 ou encore à l’inflammation vasculaire. Par exemple, la toux et l’anosmie (perte de l’odorat) étaient associées à des biomarqueurs présents en cas de réaction inflammatoire en présence d’un virus. Mais ces associations restent faibles, et semblent varier en fonction du temps écoulé depuis l’infection.
En conclusion, les mécanismes biologiques sous-jacents du Covid long constituent un groupe hétérogène, qui sont susceptibles de varier selon le type de symptômes et le temps écoulé depuis l’infection au SARS-CoV-2. Ces paramètres doivent être pris en compte dans l’interprétation des données des biomarqueurs à des fins de diagnostic, dans les efforts de recherche et les stratégies de traitements, pour favoriser une prise en charge personnalisée des patients souffrant de Covid long.
Enfin, l’étude suggère la nécessité de poursuivre les investigations en intégrant des approches « multi-omiques ». Ces approches combinent la bio-informatique avec les méthodologies de la génomique, de l’épigénomique, de la protéomique, de la transcriptomique et de la métabolomique, afin d’obtenir une vision globale et multidimensionnelle des mécanismes biologiques. Des études « multi-omiques » permettraient d’identifier de manière exhaustive les mécanismes causaux du Covid long.
En savoir plus :
- Écouter l’intervention du Pr Olivier Robineau - Podcast Avec sciences, France Culture, 20 juin 2025.
- Lire le communiqué de presse de l'Inserm